Colloque sur la responsabilité des gestionnaires publics : table ronde “Quelle(s) responsabilité(s) pour demain dans la sphère publique ?”
Acteurs publics publie l’intégralité de la table ronde “Quelle(s) responsabilité(s) pour demain dans la sphère publique ?” qui s’est déroulée le 18 octobre 2019 à l’occasion du colloque coorganisé par la Cour des comptes et le Conseil d’État.


Modératrice :
Michèle Pappalardo, présidente de chambre, rapporteure générale de la Cour des comptes.
Intervenants :
Éliane Houlette, procureure de la République
Stéphanie Damarey, professeure à l’université de Lille
Pierre-Louis Mariel, directeur régional des finances publiques d’Île-de-France
Gilles Carrez, député du Val-de-Marne
Rémi Bouchez, président adjoint de la section des finances du Conseil d’État
 Michèle PAPPALARDO
Michèle PAPPALARDO
L’objectif de cette table ronde est de contribuer à la réflexion pour aboutir à un système plus efficace et plus cohérent, qui puisse convaincre nos concitoyens que les gestionnaires publics sont réellement responsables, tout en leur laissant la possibilité de prendre des risques, d’innover et même de se tromper.
Pour commencer, je vais demander à Stéphanie Damarey, professeure à l’université de Lille, de nous dire comment les choses se passent ailleurs, chez nos voisins, en matière de responsabilité des gestionnaires publics.
 Stéphanie DAMAREY
Stéphanie DAMAREY
On aura pu constater les nombreuses imperfections qui sont celles de nos régimes actuels de responsabilité des gestionnaires publics, et en particulier des comptables publics. On a compris qu’il était temps de les repenser.
L’objectif de mon intervention est donc de proposer une première réflexion au travers de la comparaison avec les autres institutions supérieures de contrôle (ISC). Celles-ci, généralement, font l’objet d’une classification binaire, selon que l’ISC est ou non dotée de compétences juridictionnelles. C’est en tout cas la classification la plus couramment utilisée, que ce soit par la Cour des comptes européenne ou lorsqu’on fait une analyse au travers de l’INTOSAI. L’étude, y compris des ISC non juridictionnelles, apporte des informations riches d’enseignements. C’est la raison pour laquelle je ferai un tour d’horizon relativement large.
Plusieurs réserves doivent néanmoins être formulées en proposant cette approche. On le sait, une approche de droit comparé est toujours une approche délicate parce qu’il s’agit de comparer des régimes juridiques, politiques, institutionnels qui ne sont pas forcément comparables. Néanmoins, on a au moins un objectif commun, l’objectif de contrôler l’emploi de fonds publics, qui concerne finalement l’ensemble des régimes, quels qu’ils soient. En ce sens, ce rapide tour du monde permettra surtout d’identifier les modèles mis en place pour assurer ce contrôle. Cela nécessitera néanmoins d’en vérifier l’effectivité, car si d’apparence un système peut s’avérer intéressant sur le papier, il peut apparaître totalement vicié par le fonctionnement même de l’État, de l’administration ou encore de la société, ce qui aura une notable incidence sur son efficacité.
Ces réserves doivent bien évidemment être conservées à l’esprit dans le cadre de cette courte contribution. Elles vont nécessairement amener à relativiser le propos. Néanmoins, on peut déjà tirer un certain nombre d’enseignements de ce tour du monde.
Nous allons débuter très rapidement ce tour du monde par ce que nous connaissons le mieux, à savoir le régime français où nous avons juxtaposé, Madame Hirsch de Kersauson l’a très bien rappelé, la Cour des comptes d’un côté, avec notamment la compétence en matière de gestion de fait, la Cour de discipline budgétaire et financière de l’autre, avec ses imperfections puisque les ministres n’en sont pas justiciables, de même que les élus locaux pour une majeure partie. Ce modèle est quasiment inexistant ailleurs. On peut toutefois prendre l’exemple de Madagascar qui, actuellement, applique ce dispositif distinguant une Cour des comptes et une Cour de discipline budgétaire et financière. Certains États se sont engagés sur une suppression de leur Cour de discipline budgétaire et financière, c’est-à-dire que si j’avais fait le même propos il y a une dizaine d’années, le constat aurait été moins pessimiste. C’est le cas de la Tunisie où il existe encore actuellement une Cour de discipline budgétaire et financière, mais celle-ci va disparaître avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi organique qui a supprimé cette cour et qui a rapatrié dans le giron de la Cour des comptes les compétences de contrôle des gestionnaires publics au sens large.
C’est également le cas au Cameroun. La législation y a évolué récemment. Il existe un Conseil de discipline budgétaire et financière au Cameroun mais, en juillet 2018, une Cour des comptes distincte de la Cour suprême camerounaise a été créée. On lui a donné entièrement compétences à l’égard des gestionnaires publics, ce qui va nécessairement rejaillir sur la possible intervention du Conseil de discipline budgétaire et financière. On se pose effectivement actuellement la question de sa pérennité.
On l’aura compris, le dispositif est peu répandu. On pourrait aussi parler du Tchad qui a également supprimé sa Cour de discipline budgétaire et financière. Je ne vais pas m’étendre. En tout cas, on voit le parti qui est pris. Beaucoup de modèles qui étaient comparables au modèle français ont fait le choix de supprimer leur Cour de discipline budgétaire et financière, d’étendre les compétences de la Cour des comptes et de lui confier la compétence à l’égard des gestionnaires publics largement entendus.
La question se pose bien évidemment de cette étendue, concernant notamment les élus locaux et les ministres. Si on prend le cas particulier des ministres, c’est une hypothèse peu répandue même si on la rencontre étonnamment dans des pays proches et voisins de la France, en Italie ou encore au Portugal, avec l’illustration d’un ministre qui avait été condamné par son ISC en 2002 à rembourser 1,2 million d’euros pour l’achat de photocopieurs obsolètes.
Le modèle que l’on rencontre le plus fréquemment, que ce soit dans la partie sud de l’Europe ou sur le continent africain, c’est ce dispositif où il n’y a qu’une juridiction dotée de compétences à l’égard des gestionnaires publics, dont font partie les élus locaux, mais dont sont globalement soustraits les ministres.
Si je poursuis mon tour du monde, il faut que je fasse un détour par les ISC non juridictionnelles parce que même si, à ce niveau-là, il n’y a pas de responsabilité financière au sens de ce que nous appliquons en France, il existe néanmoins des responsabilités pénales ou civiles. C’est ce que j’ai envie de qualifier comme étant des ISC de premier niveau, puisqu’elles vont avoir finalement un dispositif d’alerte, pour les autorités concernées, afin que des actions au pénal, au civil, soient engagées. C’est le modèle le plus répandu à travers le monde. On peut citer l’exemple de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, du Japon, de l’Argentine, de la Namibie, du Zimbabwe, du Kenya, et la liste pourrait être très longue.
Dans ces cas-là, on pourrait également rattacher les pays d’Europe du Nord qui sont sur un modèle semblable, mais avec une dimension culturelle assez particulière. En effet, l’environnement sociétal, culturel, peut constituer un vecteur important de mise en cause de cette responsabilité. J’ai à l’esprit cet épisode dont on avait beaucoup parlé dans la presse française également, de la tablette de Toblerone qui a conduit à la démission de la ministre concernée. Les faits étaient beaucoup plus étoffés que cela : cela ne concernait pas qu’une tablette de Toblerone, on était sur 50 000 couronnes suédoises, soit l’équivalent de 4 600 euros. On l’aura compris, le modèle de responsabilité financière va comporter nécessairement un aspect culturel qu’il n’est pas forcément possible de reproduire partout, j’insiste ici, encore une fois, pour nuancer la portée de l’exercice de comparaison qui n’est pas simple.
Parmi les ISC non juridictionnelles, j’aurais tendance à identifier des ISC de second niveau, c’est-à-dire des ISC dont nous pourrions d’ailleurs presque nous inspirer pour nos compétences non juridictionnelles. Ces ISC de second niveau ont la possibilité de prononcer des amendes lorsque leurs recommandations ne sont pas suivies d’effet. On les retrouve en Bulgarie, en Croatie, en Slovénie ou encore en Slovaquie. Ce sont toujours des ISC non juridictionnelles, avec un pouvoir de recommandation comparable à ce que nous avons pour la Cour des comptes française ou les CRTC, mais avec une possibilité de prononcer des amendes en cas de non-suivi de ces recommandations.
Arrive un troisième niveau. On peut discuter ce classement, parce que certaines de ces ISC de troisième niveau se présentent comme étant des ISC juridictionnelles. Je songe notamment à des États d’Amérique du Sud comme le Pérou ou le Chili. Elles se présentent comme des ISC juridictionnelles, sauf que si on passe cela au filtre des critères qui doivent être ceux d’une juridiction, l’ensemble des éléments n’y est pas. Il nous manque très souvent des éléments liés à l’indépendance ou des éléments liés à la collégialité. C’est le cas également de l’Équateur.
Au Chili, le contrôleur général de la République peut ordonner la retenue des salaires, prononcer un licenciement, a une possibilité d’engager la responsabilité solidaire des chefs de service avec leurs subordonnés. C’est la raison pour laquelle je les classe comme étant des ISC non juridictionnelles, de troisième niveau. Elles ont un pouvoir de sanction encore plus important que ce que je viens de décrire pour le deuxième niveau, avec la possibilité d’obtenir, un peu sur le modèle des sanctions administratives, que les gestionnaires publics restituent l’argent, en soient totalement responsables par exemple. On retrouve également cela au Pérou, où le contrôleur général de la République peut prononcer des sanctions de type disqualification pour l’exercice des fonctions publiques ou encore suspension dans l’exercice des fonctions publiques allant jusqu’à 360 jours. Ce modèle ne se retrouve pas uniquement en Amérique du Sud, on peut également prendre l’exemple de l’Afrique du Sud ou encore du Soudan, où on trouve des systèmes similaires.
Indépendamment de la classification, que ce soit en ISC juridictionnelle ou non juridictionnelle n’est pas un problème en soi : l’objectif est, finalement, au-delà de la sanction prononcée à l’encontre de l’intéressé, d’obtenir la cessation des irrégularités et, en cas de préjudice causé à la caisse publique, que celle-ci soit rétablie.
On l’aura donc compris, ce tour du monde est riche de plusieurs enseignements. Il dévoile un objectif commun, assurer le contrôle de l’emploi des fonds publics, selon des modalités différentes, avec une efficacité certaine si ce n’est une certaine efficacité. Encore une fois, l’approche comparée suppose une prudence dans l’analyse et une confrontation à la pratique. Néanmoins, cette comparaison permet de confirmer les perspectives d’évolution possible des régimes de responsabilité financière, dont certains travaux ont déjà fait état – ainsi le projet de réforme de 2009 avait déjà envisagé la suppression de la CDBF. Elle permet aussi d’entrevoir d’autres possibilités, notamment dans le suivi des recommandations formulées à l’occasion de l’examen de la gestion.
Michèle PAPPALARDO
Nous allons revenir en France avec Pierre-Louis Mariel, qui est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France. Il est donc particulièrement bien placé pour nous parler de la responsabilité des gestionnaires publics puisqu’il est à la fois lui-même un grand ordonnateur et un grand comptable. Je lui ai donc demandé de nous dire comment il “rêvait” l’évolution de notre système de responsabilité.
 Pierre-Louis MARIEL
Pierre-Louis MARIEL
Je voudrais intervenir sur la responsabilité financière dans la sphère publique en partant de ce qui existe déjà, la responsabilité personnelle et pécuniaire, pour revenir sur certains points qui me paraissent majeurs et souligner d’abord ses indéniables mérites. Je reprendrais ensuite bien volontiers à mon compte l’expression de Madame la procureure générale pour souligner le fait que ce système est “à bout de souffle”. Face aux limites d’un simple toilettage du système actuel, je plaide pour une refonte complète du système de responsabilité financière des gestionnaires publics.
Un mot sur la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP), le système que nous connaissons, en soulignant tout de même ses mérites. Ils sont nombreux, j’en soulignerai succinctement trois.
Premièrement, il préserve la régularité de la gestion publique. Certes, la régularité ne doit pas être le seul angle de vue de la dépense publique. L’efficacité et l’efficience doivent être naturellement intégrées, mais sans le socle de la régularité, la dépense serait grandement fragilisée.
Deuxièmement, cela a été dit ce matin par le Premier président, cette responsabilité renforce le positionnement du comptable public face à l’ordonnateur. Contrôler des dépenses ou recouvrer des recettes, par exemple locales, peut créer des tensions entre les deux acteurs de la gestion. À l’évidence, cette responsabilité personnelle garantit l’autonomie nécessaire du comptable dans son action de contrôle.
Troisième point, souvent oublié, je voudrais souligner que cette responsabilité n’a pas été un obstacle à la modernisation de la gestion publique. Depuis vingt ans, on a rénové en profondeur le contrôle de la dépense, avec le contrôle hiérarchisé et même, pour certaines collectivités locales, avec un contrôle partenarial. On a industrialisé le processus de la dépense, avec des services facturiers. On a procédé à la certification des comptes de l’État et des établissements publics. On a dématérialisé la quasi-totalité de la dépense publique, notamment pour les collectivités locales. Tout cela, la responsabilité ne l’a pas empêché.
Deuxième élément, je vais reprendre l’expression selon laquelle cette RPP est un peu à bout de souffle. En fait, j’ai trois sujets. Premièrement, le système actuel fait que le comptable public est le seul acteur réellement responsable financièrement. Je ne reviendrai pas sur les limites de la Cour de discipline budgétaire et financière, mon voisin de gauche interviendra à ce sujet. Mais on aboutit à un système où, alors que les processus financiers font intervenir différents acteurs, les contrôles du comptable, eux, ne sont circonscrits qu’à la régularité des décisions qu’il prend en charge. Au demeurant, nous avons tous en tête des pratiques bien connues où le juge financier, ne pouvant atteindre l’ordonnateur, met le comptable en débet comme dans une partie de billard. Je ne reviendrai pas non plus sur l’exemple qu’a cité le Premier président sur l’enrichissement sans cause que certains établissements publics, notamment, utilisent dans le dispositif de gestion administrative du débet.
Deuxièmement, le système actuel me paraît reposer sur un principe d’un autre temps. Le schéma est : le débet est un manque à gagner et ce manque à gagner doit être comblé. C’était peut-être vrai en 1830, je ne suis pas sûr que ce soit encore possible en 2020. On aboutit à des situations absurdes où le montant est tel que la réparation du débet est parfaitement impossible. J’ai souvenir d’un agent comptable d’un office agricole qui avait versé des subventions à des viticulteurs, à la demande expresse des pouvoirs publics, au moment d’une crise paysanne, et qui s’est vu infliger, alors qu’il était en retraite, un débet de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Troisième élément, cette responsabilité met en jeu des procédures critiquables. D’abord, nombre d’investigations portent sur des opérations sans enjeu. Ici même, il y a un peu plus d’un an, la Cour jugeait les comptes du directeur régional des finances publiques de Bretagne que j’ai été de 2011 à 2014. J’étais intervenu en soulignant le fait qu’il y avait un grand décalage entre les enjeux financiers, plusieurs milliards, et les enjeux managériaux d’un directeur régional – il fallait que j’assure la fusion de deux administrations ; en tout, cela faisait plus de 1 700 personnes – et le résultat des investigations du juge financier. 13 000 euros de débet juridictionnel avant intervention du juge, et 1 200 euros de sommes non rémissibles.
L’autre élément, c’est que le processus est beaucoup trop long pour être pédagogique. J’évoquais le compte du directeur régional des finances publiques de Bretagne, mais les investigations portaient sur les années 2006 à 2014. La procédure n’est pas terminée puisque je me suis pourvu en cassation. On va arriver à une résolution de l’affaire en 2020 ou 2021 pour une difficulté qui a eu lieu en novembre 2011. Il faut bien voir qu’aujourd’hui, au niveau des directeurs régionaux, une bonne partie des collègues voient les arrêts les concernant prononcés alors qu’ils sont en retraite. Le côté pédagogique me paraît donc relatif.
Troisièmement, tout le monde le sait, aussi bien rue Cambon que dans les directions régionales ou départementales, ce processus, chronophage, mobilise beaucoup d’énergie tant dans les services de la direction que dans les juridictions financières.
En résumé, sur ce volet procédural, j’ai un sentiment partagé par la collectivité des comptables : “tout cela pour cela !”.
Pour autant, je considère que cette réforme de la responsabilité des comptables doit être envisagée, mais de façon complète. Cette RPP est une construction, qui d’ailleurs est très difficile à expliquer à un profane, et qui est aussi fragile. Toucher à cet équilibre très précaire, résultat de deux siècles de l’histoire des finances publiques, me paraît dangereux. Je ne pense pas que l’on puisse continuer à toiletter notre dispositif actuel. La preuve de ce côté instable et très fragile de notre système actuel est la réforme de 2011, la loi de finances rectificative pour 2011, qui avait des ambitions tout à fait louables et intéressantes, mais qui aboutit à ce que plusieurs problèmes se posent et continuent de se poser : la computation des manquements, la notion de préjudice, la prise en compte du contrôle hiérarchisé seulement pour les dépenses et pas pour les recettes. Je soulignerai quand même que c’est un sujet extraordinairement technique et complexe sur lequel, puisqu’il s’agissait d’une initiative parlementaire, l’absence de regard du Conseil d’État a peut-être contribué à aboutir à un texte qui comporte bien des chausse-trappes.
Deuxième élément, je l’ai entendu à plusieurs reprises ce matin, pour ma part – je dois être minoritaire dans cette salle –, je continue à penser que, dans le schéma actuel, l’intervention du ministre des Finances doit rester. Dans quel cadre ? En fait, dès lors qu’on est dans une logique “existence d’un débet égale préjudice financier qu’il convient de réparer”, l’atténuation financière est obligatoire. Cette atténuation, c’est au ministre de l’assurer, d’abord parce que c’est l’autorité hiérarchique qui définit au comptable les orientations, qui lui donne ses moyens, qui gère sa carrière et qui lui prescrit ses méthodes. C’est donc lui le mieux placé pour décider la part du débet qui doit rester à la charge du comptable et celle que l’État choisit d’assumer. Seconde raison, si le juge disposait de la faculté de fixer le laisser-à-charge, on peut s’interroger sur la réaction du comptable qui pourrait consister à ce que son patron ne soit plus le ministre, mais le juge. Je ne suis pas sûr que la gestion publique y gagnerait.
Enfin, troisième élément, si on confie au juge la détermination de la sanction pécuniaire, on s’oriente vers un schéma de type amende, supportée par un comptable, avec une faute du justiciable qui n’est pas toujours établie – est-ce que c’est une responsabilité sans faute ? – et une imputabilité du préjudice qui n’est pas parfaitement reconnue. On peut donc s’interroger sur ce que pourrait dire la CEDH [la Cour européenne des droits de l’Homme, ndlr] face à des comptables qui la saisiraient de décisions prises par les juges français.
Voilà pour ma part les raisons pour lesquelles je considère que des modifications limitées ne sont pas opérationnelles.
Je vais, pour finir, répondre précisément au souhait de Madame Pappalardo : quel rêve ? Faisant écho aux faiblesses de la responsabilité que j’ai évoquées à l’instant, pour moi, ce régime de responsabilité idéal a 5 composantes principales.
Premièrement, il doit comporter une responsabilité des comptables, mais aussi des gestionnaires au sens large. Le fait que la responsabilité ne porte que sur la personne qui est en bout de chaîne de la dépense ou de la recette n’est pas opérationnel ni pertinent.
Deuxièmement, cette responsabilité des gestionnaires peut prendre différentes formes. Elle peut naturellement être pécuniaire, mais elle peut ne pas l’être. Si elle est pécuniaire, elle peut être non pas personnelle, mais être reportée sur l’entité publique. On a tout un faisceau de possibilités pour rendre cette responsabilité efficace et supportable.
Troisièmement, elle doit être sélective. On ne doit mettre en jeu la responsabilité que pour des préjudices importants et non pas, comme aujourd’hui, pour des manquements sans préjudice ou avec des débets pour des sommes dérisoires.
Quatrièmement, elle doit être proportionnée et fixée par le juge en ne reposant plus sur la fiction d’un débet correspondant à un manquement financier identifié.
Enfin, cinquièmement, elle doit intervenir rapidement.
Voilà les 5 points que l’on peut identifier pour ce rêve sur la responsabilité.
Je voudrais terminer en soulignant une conviction et un espoir. La conviction, c’est que l’argent public justifie un schéma de responsabilité exorbitant du droit commun, et décalquer le schéma en usage dans les organismes privés serait une grave erreur. L’espoir est que collectivement, nous ayons la capacité à repenser complètement le schéma de responsabilité budgétaire, comptable, financier, public.
Je vous remercie.
Michèle PAPPALARDO
Merci, Monsieur Mariel, pour cette expression très complète sur ce sujet. Comme vous l’avez rappelé, nous partageons complètement le constat que le système est à bout de souffle, a perdu sa cohérence… Je ne reviendrai pas sur les différentes expressions employées. Qu’il faille aller au-delà du toilettage, nous en sommes aussi très convaincus, et dans le groupe de travail dont a parlé le Premier président, nous y avons beaucoup réfléchi. Nous ne suivons pas complètement toutes vos pistes, c’est bien normal, et il y a encore des échanges à avoir et des efforts de conviction à faire des deux côtés, mais sur un certain nombre de pistes, nous sommes bien en phase quand même. Nous avons à échanger et à réfléchir encore sur tous ces sujets.
Je vais maintenant me tourner vers Madame Éliane Houlette pour qu’en tant que magistrate judiciaire, elle nous fasse partager ce que lui inspire sa grande expérience de magistrate à dominante financière qui était encore, il y a peu, cheffe du Parquet national financier. Quels sont les sujets sur lesquels vous pensez qu’il serait particulièrement utile de faire évoluer nos pratiques et nos dispositifs actuels pour que ce système soit plus cohérent et plus efficace ?
 Éliane HOULETTE
Éliane HOULETTE
L’ancien procureur de la République financier que je suis ne pouvait être indifférent au sujet de la responsabilité des gestionnaires publics, et ce pour deux raisons. D’abord parce que réfléchir à l’avenir de cette responsabilité permet de mieux comprendre – nous en avons vu les multiples témoignages aujourd’hui – le décalage entre les attentes que nous suscitons tous et la réalité juridique et institutionnelle qui encadre notre action. Ensuite parce qu’interroger l’évolution du principe de responsabilité des gestionnaires publics, c’est interroger aussi les enjeux qui y sont attachés, des enjeux qui procèdent de l’évolution des mœurs, du rapport à la chose publique, de la mondialisation économique, et de la part de plus en plus croissante que prend le numérique dans nos vies. Le prisme du magistrat pénaliste que je suis est celui, très vaste, des manquements au devoir de probité. Ce sont, pour l’essentiel – pardon si je cite des choses que vous connaissez tous – les délits de corruption, de trafic d’influence passif, la prise illégale d’intérêt, le pantouflage, les infractions au droit foisonnant de la commande publique, le délit de concussion, de favoritisme, de détournement de biens publics, commis volontairement ou par négligence.
Aujourd’hui, on le sait, il y a des atteintes à la probité qui changent le monde lorsqu’elles sont systémiques, lorsqu’elles sont répétées et lorsqu’elles se déroulent depuis longtemps. Je veux ici prendre pour exemple tous les scandales qui sont liés à l’industrie, les scandales sanitaires et les scandales qui sont liés à l’environnement. Les atteintes ou manquements au devoir de probité ne peuvent pas être considérés comme un phénomène anodin. Pour concrétiser mon propos, pour le seul Parquet national financier, qui a été créé il y a cinq ans et demi – le nouveau procureur financier pourra communiquer le chiffre exact –, le nombre des dossiers qu’il traite s’élève aujourd’hui à 584, je crois, dont à peu près 48 % concernent des atteintes à la probité. Nous sommes saisis pour ces atteintes à la probité par la Cour des comptes, par les chambres régionales des comptes, par les corps d’inspection et de contrôle, par les administrations de l’État, par les associations de lutte contre la corruption. Nous nous saisissons également nous-mêmes, parce que nous procédons à une veille médiatique assez suivie.
Je pense que la probité n’est pas simplement une question d’individus, c’est une question de système. Le système doit être fort pour protéger l’individu qui est toujours confronté au conflit d’intérêts, à la difficulté de la prise de décision et du risque qu’induit cette prise de décision. Plus on a de pouvoir, plus on est confronté à ce risque. Je dirais que l’autorité judiciaire seule est faible. Elle est peu de choses si elle agit seule. C’est la raison pour laquelle ces moments de rencontre et d’échange sont très importants. Il faut des administrations et des autorités de contrôle très fortes pour montrer l’engagement et la détermination de l’État à agir contre les atteintes à la probité. Il le faut d’autant plus qu’on peut constater, ce qui ressort de nos entretiens de ce matin, que les processus décisionnels sont de plus en plus longs et complexes, les lieux de pouvoir sont multiples, les phénomènes de lobbying sont de plus en plus répandus, et les grandes entreprises, quel que soit leur domaine d’activité, ont des pouvoirs de pénétration puissants, directement ou indirectement.
Il y a donc nécessité d’une coordination extrêmement importante. Je ne peux plus militer dans ce sens, mais je l’ai fait tout le temps que j’étais procureur de la République financier pour que les administrations, les autorités de contrôle se rencontrent, travaillent ensemble, partagent leurs savoirs parce que nous sommes tous enfermés dans les limites de nos savoirs propres. Nous devons donc les échanger et comprendre les raisons de ce que l’on peut considérer comme une inaction.
Envisager l’avenir de la responsabilité des gestionnaires publics me conduit à formuler surtout trois observations à partir de mes cinq années et demie d’expérience et des difficultés que nous avons pu rencontrer dans la conduite de nos dossiers.
La première observation est qu’il me semble nécessaire que les règles administratives ne permettent pas la dilution des responsabilités. Cela a été dit ce matin. Le système actuel, qui donne un pouvoir général de contrôle et de surveillance aux gestionnaires publics, conduit à mon sens à diluer les responsabilités et à donner l’apparence d’une absence de responsabilité, ce qui n’est pas le cas, on le sait. Je crois que s’agissant de la responsabilité, il y a deux aspects à distinguer : qui détient le pouvoir ; qui l’exerce réellement. Il me semble très important de pouvoir retracer, et c’est le rôle du juge pénal lorsqu’il est saisi, le processus décisionnel. C’est ce qui fait que le juge pénal recherche, au-delà des apparences, la réalité de l’exercice du pouvoir.
Il me semble qu’à ce propos, la question de la délégation de pouvoir et de signature est une question centrale. Je ne suis pas du tout spécialiste, je suis même très ignorante du droit administratif, mais il me semble qu’en droit administratif, la dévolution du pouvoir est prévue par la loi ou le règlement. Les délégations de pouvoir sont possibles entre les organes de personnes morales de droit public mais, par exemple, elles ne sont pas possibles vis-à-vis des chefs de service qui peuvent assurer la direction opérationnelle des activités de service ou des activités de travaux publics. Le juge pénal lui, va s’attacher à rechercher derrière ce formalisme une responsabilité qui ne va pas nécessairement être liée à la fonction elle-même, mais à la réalité de l’exercice de la fonction. On voit là la différence d’appréhension entre le juge administratif et le juge pénal. Il me semble que pourrait être entamée ou initiée une réflexion sur la pertinence d’introduire en droit administratif l’existence d’une véritable délégation de pouvoir pour, dans un souci de cohérence, favoriser une appréhension commune entre le juge administratif, le juge pénal et le juge civil. C’était ma première observation.
Deuxième observation, plus brève, j’évoquais à l’instant la nécessité d’une plus grande transparence dans les processus décisionnels. La transparence n’est pas simplement une question de rhétorique politique, c’est devenu réellement un principe d’action qui guide les réformes du législateur, qui gouverne l’action de l’administration aussi et qui est une exigence traduite par les administrés et les citoyens. Qu’est-ce qui fait que l’on peut être suspicieux ? C’est l’absence de précision, l’absence de clarté sur la manière dont les décisions interviennent. Je crois que l’insuffisance de transparence et de formalisation du processus décisionnel – j’ai pu le constater à l’occasion de deux ou trois affaires importantes dont a été saisi le Parquet financier – favorise la perte de repères chez les décideurs publics. Un système dans lequel le processus décisionnel n’est pas transparent, n’est pas formalisé, c’est un système qui ne produit pas d’intégrité et qui ne rend pas compte. Si je devais être un peu caricaturale, je dirais que c’est un système qui ne produit pas de vertu. Encore faut-il être vertueux et qu’est-ce que la vertu ? Je crois que c’est important d’y réfléchir.
Il est important de favoriser la transparence et la formalisation des processus décisionnels jusqu’au plus haut niveau de l’État et dans toutes les instances, qu’elles soient exécutives ou délibératives. Par exemple, dans les cabinets ministériels, le processus décisionnel est, pour une grande partie, oral et informel. Cela peut être commode pour le décideur public, mais cela complique beaucoup la tâche du juge pénal qui en est saisi.
Ma troisième observation concerne les conflits d’intérêts. Je crois que c’est une question qu’il faut approfondir. Elle est traitée, bien sûr, mais de manière insuffisante. Je pense qu’au-delà du code pénal, il faut des principes qui soient déclinés dans les codes de déontologie, dans des valeurs qui sont rappelées au niveau de la formation et dans des guides de bonnes pratiques.
Pour conclure, je crois que les gestionnaires publics devraient réfléchir à développer eux-mêmes leurs propres outils de contrôle interne. La loi Sapin II a contraint les entreprises à s’organiser, à mettre en place des règles de compliance et de conformité. Je pense que nous pouvons avoir la même exigence à l’égard des gestionnaires publics.
Michèle PAPPALARDO
Je vais maintenant passer la parole à Rémi Bouchez qui va nous éclairer, avec une carrière qui lui donne de bonne raison de le faire. Puisqu’il a commencé à la direction du budget, il connaît donc bien les ministères économiques et financiers. Il est aujourd’hui président adjoint de la section des finances du Conseil d’État, mais il est aussi, ce qui nous intéresse beaucoup, membre de la CDBF et président de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c’est-à-dire de l’organe de supervision français de la banque et de l’assurance. Ce sont toutes ces expériences qui nous ont incités à lui demander de participer à ce colloque. Son cursus lui a donné de multiples occasions de réfléchir à la cohérence et à l’évolution de notre système de responsabilité publique, y compris en le comparant, je pense, à celui des acteurs financiers privés, ce qui peut être aussi pour nous une source d’inspiration – en tout cas, nous aimerions que ce soit le cas.
 Rémi BOUCHEZ
Rémi BOUCHEZ
Effectivement, j’ai l’honneur de siéger à la CDBF depuis près de sept ans. C’est surtout à ce titre, j’imagine, que ma participation est attendue. Je dirais en commençant que je suis frappé par une sorte de paradoxe qui est que cette juridiction, la CDBF, fait l’objet de beaucoup de critiques, et que pourtant certaines des pistes de réforme envisagées s’analysent finalement, en caricaturant un peu, comme une sorte d’extension de son domaine à d’autres justiciables, aux comptables peut-être, voire à d’autres gestionnaires publics. J’ai dit “en caricaturant un peu” parce qu’on oublie souvent qu’en réalité, les comptables publics sont déjà justiciables de la CDBF et que certains ont été sanctionnés par cette cour. Mais ce que je veux dire, c’est qu’un dispositif unifié et élargi de mise en cause de la responsabilité financière des gestionnaires publics emprunterait très certainement plus au régime de la CDBF qu’à celui du jugement systématique des comptes des comptables tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Or mon propos est de dire qu’il faut se garder tant de critiques excessives que d’attentes trop fortes vis-à-vis d’un système juridictionnel de ce type. Je ne vais certainement pas me lancer dans une défense et illustration de la CDBF, je partage les propos du Premier président sur le fait que ce dispositif n’est pas pleinement satisfaisant et j’adhère aussi à l’idée évoquée par Madame la procureure générale que des pistes d’amélioration devraient être explorées pour que son fonctionnement soit plus diligent, plus efficace. Mais je pense qu’un système juridictionnel répressif tel que celui de la CDBF, qui est quasi pénal en réalité, fonctionne dans un cadre juridique et procédural très contraint et, par suite, de manière forcément très sélective : je ne suis pas sûr qu’il puisse en aller autrement.
Par rapport aux attentes qui se sont exprimées jusqu’à présent dans ce colloque, celle d’une meilleure responsabilisation des gestionnaires publics, celle d’une meilleure efficacité des processus de décision publique, il ne faut pas tout attendre du dispositif ultime en aval, juridictionnel et de répression. J’appuie ce propos par trois éléments principaux, sans bien sûr détailler ici tout ce qu’implique le respect des exigences du procès équitable et de la jurisprudence de la CEDH.
Le premier, c’est que, dans un dispositif de ce type, ne peuvent être sanctionnés que des faits bien établis, qualifiés juridiquement. Autrement dit, l’infraction doit être nette, la faute bien caractérisée. Il faut qu’il y ait méconnaissance de règles ou d’obligations préexistantes. Je dirais même plus, il faut que – c’est la jurisprudence du Conseil constitutionnel – dans un système de sanctions administratives, ces règles et obligations auxquelles il est fait référence pour prononcer la sanction, à la différence de la façon dont est construit le code pénal, soient suffisamment claires pour que la sanction soit prévisible pour le gestionnaire au moment où il prend telle ou telle décision. À défaut, le principe de légalité des délits et des peines serait méconnu.
Le deuxième élément, qu’il faut bien considérer au moment où on envisage des réformes, c’est que dans un tel système répressif, l’infraction doit être nettement imputable à une ou plusieurs personnes physiques nommément désignées, puisqu’il s’agit de sanctionner des manquements individuels et non pas la défaillance d’un organisme ou d’une équipe, ou des dysfonctionnements collectifs. Or, on le sait, et je passe rapidement parce que cela a été dit, dans nos systèmes, les chaînes de décision sont souvent complexes, les intervenants sont souvent multiples, les responsabilités sont parfois diluées. Très concrètement, cela induit tant pour le Parquet général que pour la Cour elle-même des questions, des difficultés sur le point de savoir qui, dans l’équipe dirigeante d’un organisme, mérite d’être renvoyé devant la Cour et sanctionné par elle, et lorsque plusieurs personnes sont renvoyées et sanctionnées pour les mêmes faits, quelles sont les responsabilités respectives des uns et des autres. Cela a déjà été évoqué par Raoul Briet notamment.
Le troisième point, que je voudrais souligner brièvement, est qu’une juridiction répressive spécialisée, telle que la CDBF actuellement, se trouve inévitablement confrontée à la question de l’articulation de son action avec celle du juge pénal. C’est une question qui est d’abord juridique, avec le principe non bis in idem qui, je le rappelle, fait obstacle à ce qu’une personne soit poursuivie et sanctionnée pour des faits pour lesquels elle a déjà été poursuivie et sanctionnée. Je précise à cet égard qu’il ne faut pas mal interpréter les décisions de 2014 et 2016 du Conseil constitutionnel. Même si les textes ont été validés, la question continue de se poser pour la CDBF, concrètement, et principalement pour les infractions au code de la commande publique. Cela est passé assez inaperçu, me semble-t-il, mais dans au moins une affaire récente, la CDBF a tiré d’une condamnation à l’amende déjà intervenue devant un TGI sur le fondement de l’article 432-14 du code pénal, c’est-à-dire le délit de favoritisme, l’impossibilité pour elle de sanctionner les mêmes faits, c’est-à-dire une méconnaissance du code des marchés publics. C’est une décision Cipav de 2016.
Mais le problème de l’articulation avec l’action pénale ne se résume pas au respect du principe non bis in idem. Il est aussi et peut-être surtout un problème d’efficacité globale de la répression et même de la bonne allocation des ressources publiques. Est-il utile et opportun de laisser cheminer en parallèle pendant des années une procédure devant la CDBF et une procédure pénale sur les mêmes faits et les mêmes personnes, ou à peu près ? Les membres de la CDBF ici présents et peut-être d’autres auront en tête certains dossiers auxquels je fais implicitement allusion.
Ce sont là trois séries de questions que toutes les parties prenantes à l’activité de la CDBF rencontrent très souvent et dont beaucoup de ses arrêts portent la trace. Qu’est-ce que cela veut dire ? Je crois qu’il faut en déduire qu’il n’est pas si facile ou si fréquent, on doit le constater, de pouvoir constituer à l’encontre d’un gestionnaire public un dossier ayant de bonnes chances de franchir toutes les étapes de la procédure contradictoire et de déboucher sur l’infliction d’une sanction. À mon avis, c’est là l’une des causes principales, peut-être la cause principale, du nombre relativement limité de déférés – 156 sur les dix dernières années –, du taux de classement élevé des affaires par le Parquet général – un taux de classement de plus de 50 % sur la même période –et, en conséquence, du nombre assez modeste de décisions prononcées – 236 depuis 1948, je crois, et 58 au cours des dix dernières années. Mais ces questions, que je viens d’évoquer, se poseraient à peu près dans les mêmes termes à toute juridiction répressive, élargie ou réformée. Autrement dit, est-on en présence d’un manquement suffisamment caractérisé de la méconnaissance d’une règle ? Ce manquement est-il bien imputable à telle ou telle personne nommément désignée ? Enfin, une action pénale pourrait-elle être également engagée sur le même fondement ?
Notre table ronde étant tournée vers l’avenir, je tire de ces considérations deux idées, quelle que soit l’organisation retenue et que l’on décide ou non, ce qui relève de choix politiques, d’unifier le régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables, voire d’élargir le champ des justiciables de la CDBF. La première, qui se déduit de ce que j’ai dit, est qu’il faut laisser la répression juridictionnelle des gestionnaires publics s’exercer dans un champ circonscrit, celui des manquements caractérisés à des obligations claires et précises, comme l’exige la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de sanctions administratives. Cela ne veut pas dire, je m’empresse de le préciser, qu’on ne pourrait pas envisager d’ajouter d’autres infractions à la panoplie actuelle, comme celles mentionnées par le Premier président tout à l’heure. Mais il serait extrêmement risqué et en vérité inopportun à mes yeux d’élargir ou de donner un certain flou, une certaine subjectivité à la définition des infractions imputables aux gestionnaires publics, au point par exemple, mais je crois que personne ne l’envisage sérieusement, d’y inclure des choses telles que la performance insuffisante, les résultats non atteints, l’erreur d’appréciation, la prise de risque ou l’innovation malencontreuse, la mauvaise gestion. Cela relève de leur responsabilité au sens du sujet que nous traitons ce matin, mais cela ne relève pas d’un juge à mes yeux.
Il est vrai, cela a été dit aussi, que la faute de gestion n’est pas complètement absente de la jurisprudence de la CDBF. Comme on le sait, elle a été incluse dans la législation en 1995 pour les dirigeants d’entreprise publique. Mais je crois qu’on ne pourrait pas, sans prendre beaucoup de risques, en élargir notablement le champ par rapport à la pratique actuelle ou à la définition très ciselée qu’en donne l’article L. 313-7-1 du code des juridictions financières.
Deuxième point dans cette réflexion sur la construction d’un nouveau système, je crois, comme Monsieur le Premier président l’a dit dans son propos liminaire, qu’il faudrait aller jusqu’au bout des réflexions déjà entreprises sur l’articulation avec l’action pénale. Ce sont des réflexions qui ont déjà été engagées, mais qui ne sont pas achevées, car les interférences ne sont pas si rares dans le système actuel. Je n’y reviens pas plus, sauf pour dire que c’est un sujet assez complexe, notamment si on essaie d’affronter par exemple cette question du délit de favoritisme pénalement sanctionné, qui est un délit dans lequel l’élément intentionnel se confond presque avec l’élément matériel, et la sanction par la CDBF de manquements similaires.
La conséquence de tout cela à mes yeux, j’accélère beaucoup parce que cela a été dit déjà par plusieurs intervenants, notamment Jean-Denis Combrexelle : la responsabilité des gestionnaires publics ne saurait se limiter à la menace d’une sanction par une juridiction spécialisée, même rénovée ; il faut rechercher certainement d’autres voies du côté de la responsabilité managériale ou de l’amélioration de la gouvernance publique notamment.
Michèle PAPPALARDO
Je vais, pour finir, donner la parole à Gilles Carrez pour nous faire partager sa vision d’élu particulièrement impliqué dans le domaine des finances locales. Merci de nous donner votre éclairage sur le sujet de la responsabilité.
 Gilles CARREZ
Gilles CARREZ
Je vais vous faire part de quelques réflexions, mais en tant qu’ordonnateur, et à partir de mon expérience de maire, que j’ai été pendant vingt-quatre ans. Je voudrais vraiment centrer mon propos sur les questions de responsabilité financière. Les responsabilités du maire sont innombrables. Par ailleurs, à la différence de l’État, du point de vue de nos concitoyens, dans une commune, localement, il y a un seul responsable, c’est le maire.
L’idée que je voudrais développer et dont je voudrais vous convaincre, c’est que l’on a absolument besoin aujourd’hui de protéger ces ordonnateurs que sont les maires, notamment dans les petites et moyennes collectivités territoriales. Pour les protéger, il faut qu’ils puissent bénéficier de conseils, d’expertise, en amont, face à des décisions qu’ils ont à prendre et qui sont de plus en plus des décisions risquées. C’est pourquoi, à mes yeux, le réseau des comptables et la séparation de l’ordonnateur et du comptable, c’est un atout plus qu’un handicap, mais à une condition : que l’on soit capable de développer davantage, à partir de ce réseau, l’expertise, le conseil en amont, et de développer un contrôle sélectif a posteriori à côté du contrôle a priori, qui est un contrôle de régularité et qui devient de plus en plus un contrôle automatique.
Pourquoi faut-il protéger à mes yeux les ordonnateurs ? Premier point, en vingt-quatre ans d’expérience, j’ai vu cette implacable montée de la complexité. C’est tout simplement effrayant. Le foisonnement législatif, réglementaire, et l’instabilité. Le besoin de conseils pour nous, élus, s’est développé et, paradoxalement, l’État est de moins en moins capable de fournir cette expertise. Regardez par exemple dans le domaine qui concerne l’urbanisme, le logement, les réseaux, les DSP, le cadre de vie. Quand j’ai pris mes fonctions de maire, il y avait une vraie expertise dans les directions départementales de l’équipement ; elle a disparu. Par ailleurs, je constate qu’il y a même une dégradation de la qualité du contrôle de légalité. On est dans une situation plus vulnérable que celle que j’ai connue au début de l’exercice de mon mandat de maire.
Deuxième phénomène, les élus, et même les maires, même s’ils sont les derniers à jouir d’une certaine estime, d’un certain respect de la part de la population, sont en permanence sur la sellette. Là, des phénomènes nouveaux, qui ont été évoqués, jouent : les réseaux sociaux, les lanceurs d’alerte, souvent les associations, qui sous prétexte de l’intérêt général se multiplient pour défendre des intérêts purement privés. Et bien sûr, il y a les quelques affaires au pénal, retentissantes, extrêmement médiatisées, qui jettent vraiment un climat de suspicion générale à l’égard de tous les responsables politiques que nous sommes.
Cette situation, il faut l’accepter. On ne pourra pas la changer. Là aussi, les choses ont été très vite. Au début de mon mandat, on disait : “De toute façon, nous rendons compte tous les six ans. Nos décisions sont politiques. C’est l’électeur qui juge tous les six ans. Attendez les élections pour dire ce que vous avez à dire.” Cela, on ne peut plus l’accepter. Pour autant, il ne faut pas décourager les vocations et décourager les élus, et il y a un vrai risque aujourd’hui s’agissant des maires.
Un troisième point m’a frappé dans ce que j’ai connu. Nous avons de plus en plus à prendre de décisions qui sont imbriquées avec la vie économique, l’emploi, les entreprises, l’aménagement et, donc, dans des secteurs risqués. Aujourd’hui, on lance 222 opérations “Cœur de ville”. J’ai regardé certaines d’entre elles : il y a des décisions d’investissements qui incomberont aux collectivités locales qui sont véritablement risquées. Fabienne Keller évoquait cet équipement que je ne connais pas à Strasbourg, qu’elle a passé en DSP ou privatisé, avec des conséquences en matière d’incompréhension. C’était une décision difficile. Je lisais la presse sur Belfort. Belfort a fait de gros efforts pour conserver Alstom. Aujourd’hui, cela tourne mal. Que fait-on ?
Dans ce contexte, se borner à dire qu’on va rendre responsables les élus locaux devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ce n’est pas la solution. C’est vraiment à courte vue. C’est vrai qu’on l’a tenté. Je me souviens, lorsqu’il y a eu la discussion des lois Defferre en 1981 et 1982, cela avait été tenté, mais au Parlement il y avait un grand avantage, le cumul des mandats. Le Premier président sait bien que si, parfois, à 2 ou 3 heures du matin, alors que tout le monde dort, tout à coup, on évoque un sujet de collectivité locale, chacun se réveille et c’est haro sur l’État, on est tous unis pour demander à l’État de compenser, de corriger, etc. Mais cela, c’est fini. En 2009-2010, il y a eu la tentative du Premier président de l’époque, Philippe Séguin. Mais il y avait vraiment une faille dans le dispositif : les ministres n’étaient pas concernés. Allez expliquer pourquoi on voudrait créer cette responsabilité pour les ordonnateurs, les exécutifs locaux et pas pour les ministres : la tentative a donc avorté.
Mon point de vue est qu’il faut vraiment reprendre de façon différente cette question de la mise en place d’une responsabilité financière des ordonnateurs locaux, mais que je ne rejette pas dans son principe. Je pense qu’elle passe par le développement de la fonction de conseil, d’expertise en amont. Je pense que dans une situation idéale, ce serait vraiment l’inflexion, l’évolution à donner aux missions du réseau des comptables publics, mais aussi au titre du contrôle de légalité.
Cela a été évoqué à plusieurs reprises et, pour terminer, je voudrais insister sur ce point. Pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c’est, au-delà du contrôle de la régularité ou de la qualité des procédures, de développer la prévention du risque évitable – pour moi, c’est cela le cœur du sujet – et donc, comment aider à la décision.
Quelques constats rapides. Le premier constat, puisque c’est le sujet de cette table ronde sur la responsabilité, c’est qu’avec l’informatisation, la dématérialisation des procédures, le recours à des logiciels comptables, l’imbrication des responsabilités des comptables et des ordonnateurs sur l’engagement de la dépense, l’attestation, l’ordonnancement, le contrôle, le paiement, conduit à des process de plus en plus automatiques et, avec l’intelligence artificielle, cela va encore s’accentuer. La responsabilité du comptable en bout de chaîne doit être complètement reposée, je suis tout à fait d’accord avec vous, Monsieur Mariel.
Le deuxième constat, c’est que nous n’avons plus d’interlocuteur du côté des services de l’État pour nous éclairer, pour nous conseiller. J’essaie de comprendre pourquoi. Vous ne serez peut-être pas d’accord, Monsieur le directeur régional, mais la fusion du réseau comptabilité publique-impôts fait que, par exemple, dans les services comptables, on a des personnels qui n’ont fait que de l’impôt, et on n’a plus le même type de dialogue. Il y a peut-être des problèmes de formation. Je ne sais pas comment il faudrait s’y prendre pour améliorer le système.
Quelques problèmes concrets aujourd’hui pour illustrer mon propos. Je prends l’exemple de notre région. On nous a créé plusieurs niveaux d’intercommunalités. Vous avez la commune, l’établissement public territorial (EPT) – ce sont les bienfaits de la loi NOTRe –, le département, la métropole du Grand Paris (MGP), la région : 5 niveaux de collectivités territoriales. Mais si je prends uniquement la MGP, les communes, l’EPT, plus personne, y compris au sein de l’État, n’est capable de comprendre tous les mécanismes de circulation des flux financiers. Personne n’est capable de nous aider aujourd’hui sur les modalités de calcul du fonds de compensation des charges territoriales. On a perdu pied. J’étais ce matin à l’Assemblée où on discutait de l’article 5 de la loi de finances, c’est-à-dire de la réforme de la taxe d’habitation. Plus aucun maire ne sera capable d’expliquer comment cela fonctionne. Personne n’est capable de dire comment cela va être compensé. Autre exemple, quand on a mis en place le prélèvement à la source, on a eu droit à quelques tutoriels sur Internet, mais il n’y avait plus d’interlocuteur personnel à qui poser les questions du côté de l’État. Les collectivités font appel à des cabinets privés ; cela coûte cher et ils ne sont pas toujours très compétents. J’en viens à me poser la question suivante : est-ce qu’à l’avenir, il ne faut pas que les grandes collectivités se dotent d’agences comptables internes, qu’on mutualise des agences pour les plus petites communes, qu’on crée des centres de ressources et d’expertise que l’État n’a plus au niveau départemental ? C’est une véritable décentralisation et cela, je ne le sens pas non plus dans le contexte parce que la règle de séparation de l’ordonnateur et du comptable nous protège. Que de fois j’ai dit aux habitants du Perreux : “Je ne signe pas les chèques”. C’est un argument qui compte beaucoup.
Comment arriver à faire évoluer ces fonctions d’expertise et de conseil s’agissant des services de l’État ? Si je fais un parallèle, dans les grandes entreprises, ces dix dernières années, on a vu se développer des fonctions d’audit, des fonctions d’analyse de risques, des fonctions d’analyse de la conformité, des directions de la conformité. Certes, ces directions sont articulées hiérarchiquement avec la direction générale, mais la direction générale, qui prend les décisions, est tenue de recueillir les avis et les points de vue. On a des garde-fous, des systèmes d’alerte.
L’utilisation délictueuse de l’argent public qui va au pénal, je trouve qu’aujourd’hui, on l’identifie mieux et je pense que grâce à tout le travail qui a été fait, elle est davantage mise en évidence. Un certain nombre de décisions vont avoir valeur d’exemple. Cela reste un sujet, vous avez bien expliqué pourquoi il faut en permanence l’avoir à l’esprit, mais c’est un sujet qui petit à petit reçoit des solutions. Je ne reviens pas sur la question de la régularité, on en a parlé. La vraie question, c’est donc vraiment la faute de gestion, et la faute de gestion commise au regard d’un risque évitable. Comment limiter ce type de faute ? Comment la sanctionner dès lors que toutes les alertes ont été émises, que les garde-fous ont été délibérément franchis et que malgré toutes ces mesures de prévention, la faute a été commise ? Là, je suis d’accord avec l’idée d’une mise en jeu d’une responsabilité, d’un système d’amendes qu’il faut définir. Mais c’est très difficile.
Je vais terminer par un exemple qui m’a beaucoup frappé dans mon activité de maire et député : c’est l’affaire des prêts toxiques, parce que je l’ai vraiment vécue de près. Nous sommes en 2006. Un certain nombre de banques que je ne citerai pas viennent vous démarcher et vous disent : “Monsieur le maire, nous avons un produit magique, nous allons vous permettre de diminuer les intérêts de votre dette en section de fonctionnement d’ici les élections municipales – qui avaient lieu deux ans après – et vous allez pouvoir prendre une décision de baisse des impôts avant les municipales.” Il s’agissait tout simplement de refinancer sa dette, en empruntant en yens, en francs suisses, en empruntant sur l’évolution du cours futur du franc suisse par rapport au yen, etc. J’ai reçu ces gens, je leur ai posé une seule question : est-ce que je paie mon personnel en yens ? Est-ce que je le paie en francs suisses ? Quels sont les instruments de prévention, de garantie ? Je n’ai pas eu de réponse. Nous n’avons pas pris.
Mais beaucoup de voisins se sont précipités. Peut-être les alertes n’ont-elles pas été suffisantes. Le réseau des comptables aurait pu dire que c’était très dangereux et montrer les risques. C’est vrai que ce travail n’a pas été fait. Que s’est-il passé après ? Ils ont emprunté des milliards de prêts toxiques. À l’Assemblée, nous n’avons été que deux, avec mon ami Charles de Courson, à dire qu’il est hors de question que la collectivité publique, avec les impôts de tous les Français, aille au secours de fautes de gestion délibérées qui ont été commises. Que croyez-vous qu’il advint ? On a créé un fonds de plusieurs milliards et la moitié de ce fonds a été financée par l’impôt des Français.
Comment matérialiser, comment bien définir la faute de gestion ? Pour moi, c’est aujourd’hui la question principale dans le domaine de la responsabilité financière.
Michèle PAPPALARDO
Je vais passer la parole tout de suite à Monsieur Mariel, car j’imagine qu’il a des tas de choses à dire en réaction ou en complément de ce que vous avez dit.
Pierre-Louis MARIEL
Juste un mot sur 4 points que vous avez soulignés, Monsieur le député.
Sur les emprunts toxiques, premièrement, il n’appartient pas au comptable public, qui fait un contrôle de régularité, d’intervenir sur ce sujet. Deuxièmement, pour les comptables qui l’ont fait, on leur a renvoyé “dans les dents” – passez-moi l’expression un peu triviale – : “Oui, mais cela va me faire gagner de l’argent et votre prudence est excessive au regard du gain que je vais avoir.” Donc, les responsabilités sont quand même très partagées.
Sur le renforcement du conseil que vous appelez de vos vœux, c’est exactement une des deux priorités du nouveau réseau de proximité de la DGFIP que nous sommes en train de construire, vous le savez bien puisque ma collègue vous a rencontré à plusieurs reprises sur ce sujet pour le Val-de-Marne.
Sur l’agence comptable, on peut peut-être penser que, théoriquement, c’est une excellente chose. J’observe qu’il y a un an, il a été lancé un appel à candidatures pour aller vers l’agence comptable. Il y a seulement eu deux candidatures. Il y en a eu d’autres, fantaisistes. L’une concernait un élu bien connu de l’Ouest parisien, on l’a refusée. Aujourd’hui, la parenthèse est close.
Enfin, sur le prélèvement à la source, je vous trouve un peu sévère parce que je trouve que la mobilisation qui a été celle de notre administration, pour la réussite de cette vraie révolution pour le contribuable et l’impôt, est à souligner.
Michèle PAPPALARDO
Merci. Sur le dialogue entre les juges, puisque nous avons des questions sur le sujet et que vous l’avez plus ou moins évoqué les uns et les autres, voulez-vous reprendre la parole, Madame Houlette, ou un autre intervenant ?
Éliane HOULETTE
Quelques mots simplement, c’est un dialogue qui existe déjà, que l’on ne peut qu’encourager parce que chacun est dans sa sphère d’activité, dans sa sphère de compétences. Pour l’expérience du Parquet financier, le travail a consisté à travailler de façon très étroite avec les administrations, les autorités de contrôle. Bien entendu, un de nos premiers partenariats était avec la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes. Il ne peut qu’être encouragé. Il peut toujours être perfectionné, mais il existe.
Michèle PAPPALARDO
Monsieur Bouchez, nous avons une question qui s’adresse directement à vous sur la manière dont vous pouvez tirer des enseignements de ce que vous voyez du côté des banques et des assurances.
Rémi BOUCHEZ
Juste un mot sur la question précédente, mais Madame Hirsch de Kersauson le dirait beaucoup mieux que moi. Je crois que du côté de la CDBF aussi, il y a des échanges. C’est au niveau du Parquet général, pas au niveau de la formation de jugement elle-même, mais il y a des échanges nourris et fréquents entre la juridiction financière et la juridiction pénale.
Sur l’expérience que l’on peut tirer des procédures de sanction, notamment dans les autorités de régulation, je dirais juste, un peu à l’appui de mon propos précédent, que le plus souvent, ces dispositifs de sanction – c’est le cas pour ce que je connais le mieux, c’est-à-dire l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la structure de supervision des banques et des assurances – ne sont qu’un élément d’un dispositif plus global. L’ACPR émet du droit souple. Elle fait des contrôles qui se traduisent par des mesures administratives, des mesures de police, des injonctions, des mises en demeure, et la sanction est conçue comme le stade ultime, le stade aval où, pour les manquements les plus graves, on prononce une sanction avec un fort effet pédagogique et dissuasif recherché. Mais, que ce soit à l’ACPR, à l’AMF [l’Autorité des marchés financiers, ndlr] ou dans d’autres autorités de régulation, par rapport à l’ensemble des prescriptions, des recommandations, des conseils qui sont fournis aux entreprises qui sont sous supervision, le nombre de sanctions est assez modeste. À l’ACPR, c’est une dizaine par an.
Michèle PAPPALARDO
Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir sur les différentes interventions. Nous avons beaucoup de questions sur le thème “comment renforcer le régime de sanction sans décourager les gestionnaires publics, les élus, mais pas uniquement les élus, les ordonnateurs aussi ?” Y a-t-il des pistes qui vous paraissent plus intéressantes que d’autres ? C’est en tout cas une des questions qui revient le plus souvent.
Stéphanie DAMAREY
Je pense que déjà, il faut, en donnant plus de champs de compétences et de latitude au juge financier, lui permettre finalement d’intégrer totalement l’office d’un juge, en l’occurrence d’un juge des comptes. On parlait de la remise gracieuse tout à l’heure. Cela tétanise totalement l’office du juge des comptes puisqu’on a bien conscience que, lorsqu’une décision de justice est remise en cause par une décision administrative, cela ne donne plus tout son intérêt à la procédure. Le Premier président en avait parlé dans son allocution d’introduction. Le système de remise gracieuse se voit encore dans quelques pays, mais vraiment très peu. On le trouve notamment en Mauritanie. Dans d’autres pays d’Afrique, on trouve un système de grâce présidentielle. C’est la grâce présidentielle qui est accordée au comptable.
Michèle PAPPALARDO
Monsieur Carrez est revenu sur le sujet de la responsabilité des ministres, dont il dit qu’effectivement, on ne l’a pas traitée spécifiquement, mais dans une vision globale. Monsieur le député, vous n’avez pas pu assister au début de notre colloque ; aussi vous n’avez pas pu entendre le discours du Premier président, qui vous aurait complètement rassuré sur le fait que nous souhaitons effectivement mettre “dans le même panier” les ministres et les élus, mais avec beaucoup de précautions et, comme vous le disiez, après avoir notamment travaillé sur la prévention des risques. Pour moi, c’est un sujet vraiment important de travailler sur la prévention des risques évitables et beaucoup d’interventions que vous avez faites, dans les deux tables rondes, vont dans ce sens. Cela veut dire que ce sont des réformes beaucoup plus lourdes et complexes que de seulement savoir si ce sont les comptes ou les comptables que nous jugeons, etc. On voit bien que c’est tout en amont de l’organisation de nos administrations, de notre fonctionnement entre collectivités et État, que se posent les problèmes et qu’il va falloir y travailler, en cohérence avec un système de responsabilité des ordonnateurs, des comptables, des gestionnaires publics d’une manière générale, qui doit être plus “explicable”. Vous l’avez dit plus ou moins les uns et les autres, et je reconnais que je suis, moi-même, absolument incapable d’expliquer à un citoyen “normal” le système actuel de responsabilité des gestionnaires publics, et cela n’est pas bon signe.
Voir la table ronde en intégralité
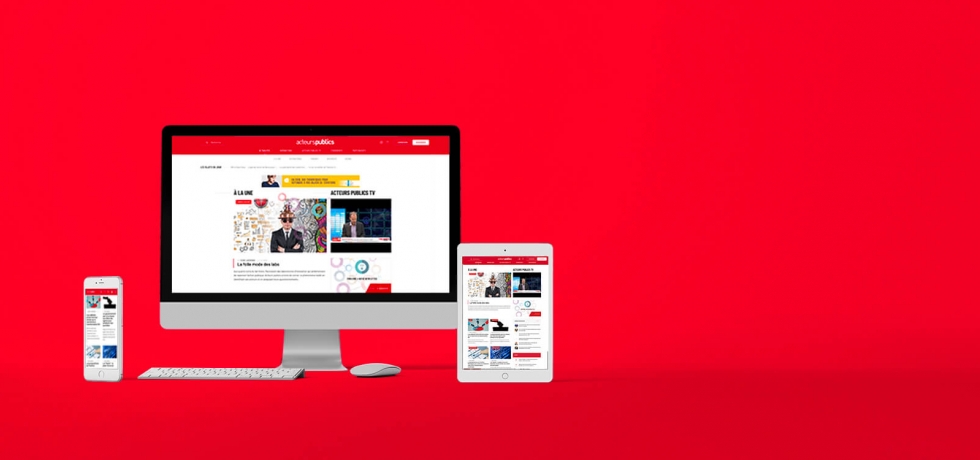
ÉTAT | COLLECTIVITÉS | HÔPITAL
L’essentiel du management public
FORMULE INTÉGRALE
1200€ / an







